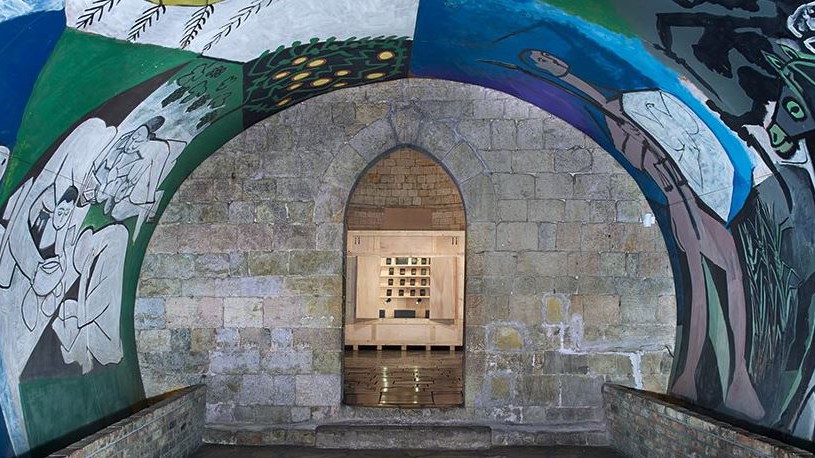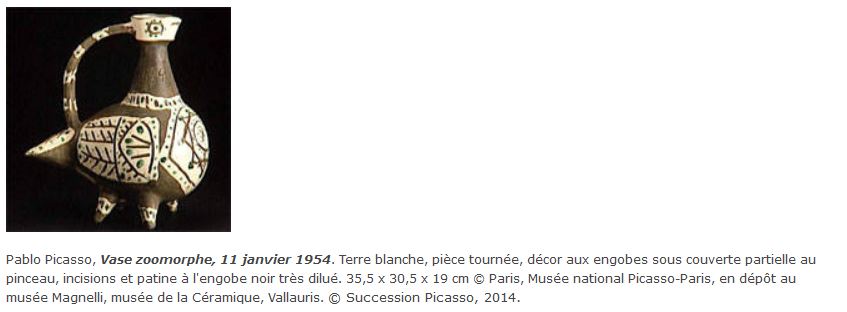EXPO
PABLO PICASSO
La chapelle
La chapelle romane

Le choix de la chapelle de Vallauris pour installer La Guerre et la Paix : Les deux œuvres de Picasso La Guerre et la Paix sont installées dans la chapelle du château de Vallauris en 1959.
Le choix par Picasso de la chapelle pour l'édification de son temple de la Paix s'inscrit dans un mouvement de redécouverte de l'art sacré,
qui connaît un indéniable engouement dans les années 1950 : Matisse
achève la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence, Chagall - ainsi
que Bonnard, Léger, Germaine Richier - participent à la décoration de
l'église du Plateau d'Assy, Notre Dame de Toute Grâce. Il commence
également à travailler à son monumental Message Biblique, qu'il destine
d'abord à une autre chapelle vençoise avant d'en faire don à l'Etat.
Pablo Picasso, conscient du profond symbolisme du lieu et séduit par les
rigoureuses proportions de l'austère bâtiment, choisit la chapelle du
château de Vallauris.
L'édifice ancien contribue à donner à La Guerre et la Paix, avec ses évidentes références à l'art antique, voire à l'art rupestre,
un ancrage sacré et universel. "Il ne fait pas très clair dans cette
chapelle, déclare l'artiste à Claude Roy, et je voudrais qu'on ne
l'éclaire pas, que les visiteurs aient des bougies à la main, qu'ils se
promènent le long des murs comme dans des grottes préhistoriques,
découvrant les figures, que la lumière bouge sur ce que j'ai peint, une
petite lumière de chandelle."
Luc Thévenon, conservateur du musée Masséna à Nice présente l'édifice qui abrite aujourd'hui La Guerre et la Paix de Picasso :
"Aldebert,
évêque d'Antibes et co-seigneur de ce lieu avec son frère aîné
Guillaume Ganceran, cède son fief de Vallauris au monastère de Lérins
par acte en date du 9 décembre 1038. Ce domaine s'accrut des possessions
cédées en 1046 par Pierre Signier et son fils Guillaume au moment de
leur prise d'habit à Lérins.
Les donations sont d'abord contestées
par les ayants droit d'Aldebert, notamment par Foulques de Grasse qui
les occupe à tel point que le pape Honorius II doit le menacer
d'excommunication en 1124 pour obtenir une rétrocession en 1131. Les
comtes de Provence confirment les droits de l'abbaye de Lérins plusieurs
fois au XIIème siècle. En 1227, le père abbé avait autorisé Dame
Aiceline à fonder une petite communauté de femmes en utilisant certains
bâtiments dont la localisation reste très controversée. Au cours du
XIIème siècle, l'abbaye fait construire un castel et sa chapelle pour la
résidence du prieur, seigneur délégué du fief, aidé au moins de deux
moines, imposés par les statuts de 1353. Si la chapelle a été conservée,
le château actuel est une reconstruction de 1568 dont l'escalier
Renaissance est classé.
La chapelle est un édifice à nef unique, ses élévations lui confèrent une monumentalité inhabituelle. Deux travées couvertes d'une voûte en berceau brisé s'articulent à une abside en cul-de-four
par un large arc brisé. Les murs présentent un moyen appareil à la
stéréométrie soignée mais avec des traces visibles de mortier. A
l'extérieur, cet appareil comporte des éléments de nature géologique
variée : moellons gris, roses, ocres qui donnent beaucoup de charme à
l'édifice. Un simple bandeau de section carrée court à la limite
murs-voûte sans retour sur des pilastres. Les baies, deux opposées par
travées, sont soit encadrées de claveaux très ajustés (au sud), soit
surmontées d'un linteau monolithe échancré en arc d'une technique
beaucoup plus fruste. L'abside très haute présente un grand appareil
plus régulier à la stéréotomie parfaite. En grande partie visible de
l'intérieur du château (salle basse en sous-sol et premier étage avec
fenêtre axiale) elle est confortée par une haute plinthe reposant sur un
lit de blocs grossiers.
Aucune date ne précise la consécration
de la chapelle : cet édifice a pu être construit après le milieu du
XIIème siècle, puis remanié ou restauré début XIIIème siècle, date à
laquelle on rattache la belle abside et les baies sud. Le portail sud,
avec ses quatre consoles soignées mais purement géométriques, devrait
être attribué à cette restauration.
L'église Sainte-Anne de
Vallauris s'insère dans un important ensemble de constructions en
Provence orientale. Elle est très proche de Sainte-Anne du Suquet et de
la salle capitulaire de Saint-Honorat qui sont deux autres
constructions lériniennes. Plus largement, il faut la situer dans un
ample mouvement de rénovation, dernier élan de l'art roman dans cette
région, dont témoignent avec des décalages d'une ou deux décennies
antérieures ou postérieures, l'église de Saint-Cézaire et dans
l'environnement montagnard, celles de Girs, de Gréolières-Hautes ou de
Coursegoules notamment.
Légende : chapelle romane de Vallauris, musée national Pablo Picasso, La Guerre et la Paix. © Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © cliché P.Gérin.
Picasso à Vallauris
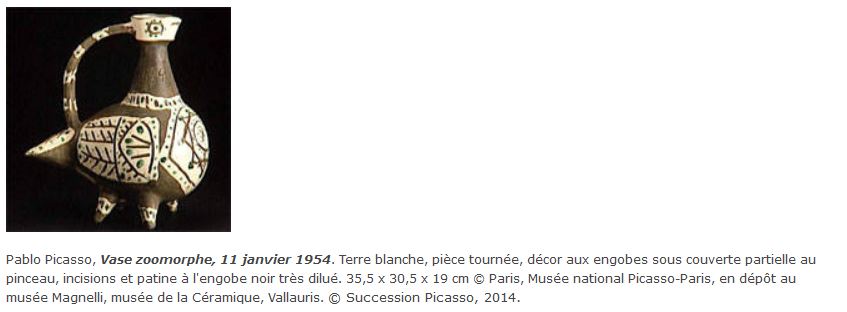
Après
la Deuxième Guerre mondiale, Pablo Picasso choisit de vivre et de
travailler sur la Côte d’Azur. Son fort attachement pour la méditerranée
l’amène tour à tour à Antibes et avant Cannes et Mougins, à
Vallauris où il séjournera de 1948 à 1955. Installé dans son atelier du Fournas,
ancienne fabrique de parfum, il travaille intensément, réalise de
nombreuses œuvres et expérimente une technique nouvelle pour lui : la
céramique qui retint tout particulièrement son attention et qui motiva
sans doute son installation à Vallauris, ville connue pour son industrie
potière.
Ce sont des milliers d’objets que Picasso créera dans l’atelier de céramique Madoura, dirigé depuis peu par Georges et Suzanne Ramié.
Assiettes, plats, vases, pichets et autres ustensiles de terre furent
ainsi peintes et décorés avec émaux et oxydes métalliques qui, de par
leur nature et pour le plus grand plaisir de l’artiste, hypothéquaient
toujours le résultat final. Mais les mêmes objets, sortis du tour du
potier, pouvaient aussi être transformés. Quelques torsions habilement
produites les métamorphosaient en animal ou en nu féminin, en faune ou
en tanagra.
Si le séjour de Picasso à Vallauris reste
indubitablement marqué par cette prolifique création céramiste,
l’artiste ne délaissa pas pour autant les techniques habituelles comme
la
gravure sur linoléum ou la sculpture dont il révolutionna également le principe d’exécution en y intégrant des objets récupérés (La Chèvre, La Femme à la poussette, La Guenon et son petit...) ou la peinture qui entame alors un dialogue explicite avec les œuvres des grands maîtres (Portrait d’un peintre d’après Le Greco, Les Demoiselles au bord de la Seine d’après Courbet).
En cette période d’après-guerre, l’art de Picasso fait aussi place à certains épisodes de l’histoire contemporaine. Massacre en Corée, Le Charnier et le fameux Portrait de Staline
témoignent de l’engagement politique de l’artiste qui, en dépit de son
adhésion récente au Parti communiste, poursuit son questionnement sur
la forme et travaille à sa transformation sans aucunement souscrire aux
préceptes du réalisme socialiste. Les terribles développements de
l’histoire récente ne sont donc pas absents dans l’œuvre de Picasso mais
ils n’y figurent pas explicitement. Des indices seulement permettent
de penser que les temps précaires que le monde a vécus restent présents
dans son œuvre : objets disloqués que l’on peut voir dans les
nombreuses natures mortes de cette période, crânes humains ou animaux,
lampes diffusant une lumière blafarde qui encadre sévèrement
l’ensemble. Les formes abruptes que Picasso donne aux objets, les
camaïeux de gris auxquels il limite sa palette sont, à n’en pas douter,
les éléments qui rendent compréhensible la déclaration de l’artiste :
une casserole aussi ça peut crier ! Tout peut crier !
L’œuvre que Picasso réalisa durant les sept années où il habita Vallauris est riche aussi de ce qu’il y vécut. Françoise Gilot,
sa compagne d’alors, tout comme Claude et Paloma, les enfants du
couple sont fréquemment représentés dans sa peinture. Ils vaquent à
leurs occupations ou apparaissent frontalement sur la toile. Le paysage
méditerranéen, la ville même de Vallauris, avec les fumées noires des
fours au moment de la cuisson, sont également les thèmes traités par
l’artiste. A l’instar de l’ombre créée par les fumées citadines
apparaît, dans certaines représentations de nus féminins (
L’Ombre, L’Ombre sur la femme,
tous deux de décembre 1953), celle de l’homme sur le corps allongé de
la femme, alors même que les relations de Pablo et de Françoise
connaissent une grave détérioration.
Dès sa rencontre avec Jacqueline Roque
– jeune fille qui deviendra sa deuxième épouse - le peintre lui fait
place dans ses tableaux. C’est l’époque où Vallauris connaît une grande
effervescence. En effet, la présence de Picasso est à l’origine d’une
véritable émulation artistique : les peintres et sculpteurs Victor
Brauner, Marc Chagall, Edouard Pignon, Ozenfant, Prinner… viennent
travailler dans les ateliers de céramique.
La restauration de La Guerre et la Paix en 1998

Pablo Picasso, La Guerre, 1952. Huile sur bois, isorel, 4,70 m x 10,20 m. © Vallauris, chapelle, musée national Picasso. © succession Picasso, 2014.
La restauration de La Guerre et la Paix
a été effectuée sur place à Vallauris, durant le premier trimestre
1998, sous la maîtrise d'œuvre du service de restauration des musées de
France. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire des musées de
France à Paris et par le Centre national d'Evaluation de
photoprotection à Clermont-Ferrand.
La restauration de La Guerre et la Paix, étude de l' œuvre et découverte
L'œuvre,
peinte avec un matériau à base d'eau, non vernie, n'avait pas été
restaurée depuis sa création en 1952. Les couleurs étaient encrassées et
les coulures d'eau avaient provoqué des décollements de la peinture et
des blanchiments. Le support de l'œuvre, 46 panneaux d'isorel sur une
armature de bois fixée au mur par des pattes métalliques, avait
également souffert de l'humidité entraînant le gonflement et le délitage
des panneaux à la base. La poussière et des gravats s'étaient
accumulés au revers des panneaux, provoquant des déformations de la
courbure.
Lors du démontage, fut découvert sur le crépi ancien du
mur, un dessin au fusain représentant une figure humaine. La
restauration impliquant une dépose pour laquelle la réalisation des
contre-formes respectant la courbure de chacun des panneaux fut
nécessaire. Les panneaux ainsi déplacés sans modification de leur
courbure ont ensuite été déposés sur des berceaux également aux mêmes
formes. Le nettoyage a consisté, selon les zones, en lavage ou gommage,
puis refixage des parties délitées, et reconstitution des quelques
petites lacunes. Ce nettoyage a permis le rafraîchissement des couleurs
et la remise en valeur des matités et des brillances. Les panneaux ont
ensuite été remontés à l'aide de contre-formes sur l'ancienne
structure, en excellent état. Le dessin au fusain a été refixé, puis
photographié, a été recouvert lors du remontage.
Restauration, conservation préventive et respect du lieu
La
restauration a été entreprise à l'issue d'importants travaux
d'assainissement de la chapelle, visant à supprimer les causes externes
d'humidité. Ces travaux ont été poursuivis lors de la dépose des
panneaux par le décapage de la voûte rétablissant la capacité initiale
d'aération, garante de la bonne conservation des structures de bois. La
muséographie a été revue avec la discrétion qu'exigent le respect des
conditions de la présentation de l'œuvre voulues par Picasso et la
sobriété d'une architecture du XIIème siècle. L'éclairage de l'œuvre
notamment a été repris. La spectaculaire restauration de cette œuvre, a
été assurée par le service de restauration des musées de France, dont
Gilles Barabant, chargé d'études au service de restauration des musées
de France en collaboration avec Daniel Jaunard, Patrick Mandon et Jean
Perfettini, restaurateurs ébénistes, Nathalie et Aloÿs de Becdelièvre,
restaurateurs de la couche picturale, Florence Cremer, restauratrice de
peinture murale.
Tarifs
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 € (groupes à partir de 10 personnes, séniors, étudiants)
Gratuité : enfants jusqu’à 18 ans inclus et habitants de Vallauris Golfe-Juan.
APPELEZ LE MUSÉE POUR ACHETER VOS PLACES A L'AVANCE OU POUR TOUTES QUESTIONS SPÉCIFIQUES
Ouvert le dimanche

 SéjournerHôtels, ...
SéjournerHôtels, ... VisiterMusées, ...
VisiterMusées, ... SortirRestaurants, ...
SortirRestaurants, ... CommercesMode, ...
CommercesMode, ... LoisirsPlages, sports, ...
LoisirsPlages, sports, ... ServicesTourisme, ...
ServicesTourisme, ...